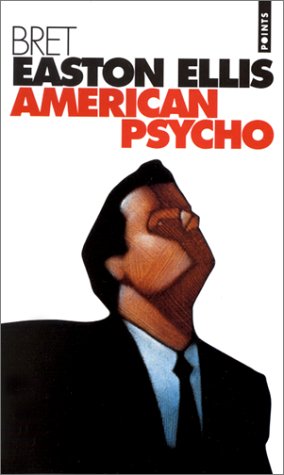
Quel genre de lecteur voudrait lire un livre dont le héros est un yuppie? Le milieu de la finance n’est il pas avant tout le règne de la médiocrité, où l’on serait essentiellement guidé par l’argent et l’attrait du pouvoir. Ce monde de vide est éloigné du vide de moins que zéro. On imgagine facilement un monde antédiluvien figé dans l’artificiel, mais au lieu de ça on trouve des vrais gens aliénés et pris dans les noeuds de la modernité.
Le narrateur pourrait être une caricature issue d’un moule paternel privilégiant l’égo. L’arrivisme semble légitimer la domination, qui devient un moyen pour s’approcher d’une idée de pouvoir. Le meurtre semble être l’issue de ce pouvoir qui invite au cynisme et on y voit comme dans la pornographie une projection de rapports de classe dans la violence sur l’autre, la domination physique consolidant la loi du plus fort.
Dans ce rapport de force, sans lumière dans le narrateur, on aimerait plus s’identifier au second rôle sans personnalité qu’à ce je détestable. On espère voir une lueur, mais l’aveuglement du second rôle le place comme victime consentante, complice au travers de sa volonté de profiter du moule de son hypocrite naïveté. Si on ne peut sortir du je, la persona semble être la prison où on penserait pouvoir fuir sa pulsion de mort.
Le vide La superficialité semble être le milieu qui permet au narrateur de garder une place pour ses besoins inavoués. Sur son chemin, le narrateur n’apprend rien. Il glisse dessus sans parvenir à trouver une accroche. Peut être que son assistante ne se sauve que parce qu’elle est tellement bloquée dans sa tête, et à côté de la plaque, qu’il ne peut rien en tirer. Il y a quelque chose de gay dans le cynisme à aller vers une femme tout en ne la considérant pas, tout en ne dévoilant que sa part animale, seule part sincère et immuable qui lui reste, sans aucun but, avec la simple capacité à rendre compte d’un rapport de force. Peut être que revenir aux besoins animaux, au corps, permet de changer de point de vue, et de distinguer par contraste les blocages, le lieu où l’action est sublimée ou entravée.
Un jeu dans une société cadenassée Le monde qui entoure le narrateur a délégué aux signes, aux règles des apparences et à une société qui a investi dans le marchandage de ces signes sa capacité à juger. Ce jeu de masques permet au narrateur de refouler une partie de lui même, de ne pas s’enfoncer dans le pathos et d’accueillir le présent, non comme il est pas rapport à son histoire, à son point de vue, mais dénué de point de vue, possiblement absurde, possiblement tragique. Il pense être en phase avec son époque, dans la conscience d’un cynisme conformiste, où le recul critique serait une bizarrerie sans rapport avec une réalité condensée dans le surinvestissement des signes.
Jean semble être la seule à se questionner, à chercher l’intention sans pouvoir la comprendre, et dans sa curiosité ne peut que s’étonner du caractère illogique des intentions, comme dans une comédie, comme si elle était témoin du vide intérieur. La disparition du sens est comme punie et exploitée par le narrateur qui ne fait que décevoir le monde à avoir déléguée leur conscience au système. Dans le mensonge, il y a une recherche d’un soi protégé des projection des autres, d’une annulation du sens des signes, qui tire au narcissisme, mais qui fait aussi appel à la réaccaparation du corps.
Peut être le narrateur embrasse un univers où l’amour est absent, celui du père vide de sens, avec l’accès à un succédanné d’amour à la condition qu’il ait un succédanné de vie, pour espérer ainsi échapper à la condamnation de ses travers criminels. Le masque vide du golden boy extension de l’enfant innocent devient parfois une camisole où son surmoi n’a plus d’espace pour évoluer.
L’impuissance du lecteur
L’auteur semble placer le lecteur face aux situations de la vie où il se coupe du réel. Face à un trader, le lecteur pourrait se placer en position inférieure, par ignorance, ou refuser toute association, mais dans ce cas là ne pas affronter la réalité qu’il refuse. Il lui donne alors un accès en déconstruisant l’aura de la persona de personne d’autorité, qui ne peuvent attaquer en public, et qui doivent limiter leur action au monde physique. Le lecteur est placé devant son inaction face à l’immoral. Si celui capable, qui n’est pas dans le déni, déverse librement sa haine, sa colère sur l’autre, où est passée celle du lecteur? L’auteur lui permet de se confronter par le roman à cette colère, en lui donnant un espace, où il ne se fera pas posséder par elle dans la vie de tout les jours. Il invite même à accueillir la violence.
L’auteur semble dénoncer le côté mortifère de la vision du lecteur qui condamnerait le monde par les apparences pour tenter de s’en soustraire et se créer un monde idéal illusoire sans collision avec le monde réel. Mais en faisant celà il fige cette vision. Probablement l’auteur a dû faire face à ce conflit intérieur, où l’isolation émotionelle ne mène à rien. Les illusions héritées de son éducation se sont confrontées à une réalité différente de son corps, avec une proximité de la violence de ces illusions devenant une menace pour l’autre. Même les scènes de sexe illustrent un questionnement sur ce que ne se permet pas le lecteur.
Le lecteur peut se confronter à ses désirs, à la médiocrité de ses désirs, à sa vulnérabilité quand l’attention se porte sur lui même malgré la présence d’une femme qui ne l’aide pas à canaliser ses désirs mais le laisse avec ses pulsions. D’un certain côté le narrateur est vulnérable car il ne pense à rien et il est d’autant plus vulnérable qu’il est submergé par son ombre qui finit par le contrôler complètement. Il y a une invitation à reconnaître son ombre, et ne pas se laisser succomber, ne pas s’identifier à l’ombre qui n’est pas soi. Un risque est de se conformer à une image d’une libéralisation sexuelle, et de chercher à correspondre à cette image comme s’il y avait quelque chose d’adulte à ça, ce qui pousserait à plus d’aliénation et à ne pas intégrer sa propre ombre. C’est un problème de la pornographie de chercher le pire car il rate toujours à chercher l’ombre, mais crée un conformisme innatteignable.
Le lecteur peut lire de façon inversée le livre si l’ombre le submerge, s’il s’identifie trop à son ombre. La persona, la superficialité est l’ombre de l’ombre et il y a un espoir à reconstruire cette persona.
On ne sort peut être pas de la médiocrité
La répression des pulsions de la journée a des répercussions sur les individus qui déchargent la violence dans les relations humaines de façon souvent symbolique. Le narrateur quand il se libère de ses obsessions, a l’impression de se dépersonnaliser, puis revient dans la société comme s’il retrouvait qui il était. Ainsi il donne de la place à son ombre. Un autre chemin serait une action mais qui ne suit pas ce contrôle pulsionnel, mais placerait le réel dans le récit pour ne pas s’y soumettre complètement.
Malgré la société, il reste des personnes qui acceptent l’ignorance, et croient encore en un jeu dans le récit, Jean par exemple qui reste interprète mal chaque situation avec amusement sans opportunisme car plus bas dans l’échelle sociale, Carruthers qui ne voit pas les bons signes. L’auteur trouve un regard à demi intéressé, à demi ennuyé, avec une tendresse cachée, sur les petits détails, les micros événements qui tracent une forme de tragique, qui fait la vie des idiots, les personnes aliénées, des insensibles, qui perdent le lien avec le sens de leur vie. Il laisse la satire aller jusqu’au bout entre ceux qui ne s’accordent à rien.
Dans la répétition de l’erreur, à travers Jean qui aime par erreur, en restant en dehors d’un sens voulu et qui espère voir sans définir ce qui est, on décèle une foi en une forme d’ouverture, malgré l’absence de mérite, à travers une espérance, au delà de la vérité ou de la justice, celle de continuer de vivre, d’avoir des interactions humaines pour peut être se faire embrouiller et d’entrer dans un jeu différent, d’essayer d’agir et de juger sans s’entraver, sans faire appel à une autorité dévitalisée, de ne pas se voir comme une île et se rabaisser au trivial car c’est dans du trivial que vient l’énergie, en restant au contact, même médiocre et de faire avec. Il y a aussi ce blanc entre les épisodes, qui peuvent être une préparation à ce qui arrive dans le monde, qui peut être une parenthèse du possible.
Le narrateur narcissique semble être un miroir négatif du lecteur de gauche imbu de ses valeurs. Les valeurs d’égalité sonnent creux dans ce monde lorsqu’ils ne restent qu’à l’état de paroles. D’un certain côté le narrateur dans sa caricature permet au lecteur de sortir de son narcissisme, grâce à un travail sur les apparences entièrement tournées vers un autre d’un milieu qu’il ne respecte pas. S’il y a volonté de pouvoir ici, il y a une possibilité de détourner la finalité de l’histoire, de détourner le pouvoir, de ne pas tuer l’autre, dans le but inavoué de sauvegarder un narcissisme existentiel.
Il y a comme une invitation à affronter le décalage entre la persona et son intérieur, à s’accepter sans amour, sans bonne intention, à assumer sa médiocrité. L’important est de partir de soi, même d’un soi médiocre, et pour les autres partir des autres et reconnaître qu’il ne se passera rien dans la journée, dans le cadre, si on se limite à la persona, qui permet à l’autre de se rassurer, mais cela en niant tout risque de rencontre avec l’autre. Il y a un exercice à rester ouvert malgré l’ombre en soi qui se veut invasive, un autre à ne pas se laisser brider par sa propre persona et se permettre de se voir comme un criminel, un autre aussi à ne pas prendre une hauteur qui déconnecte de la vie dans lequel les mythes ne seraient pas vivants. L’autre est vue comme largué par rapport à soi, mais c’est normal, il ne peut ne pas l’être, et l’auteur invite le narrateur à le prendre en compte et c’est dans ce contexte que l’humour peut apparaître, l’humour de la situation. L’autre n’est largué que de façon artificielle, que dans le problème d’égo du narrateur. Il y a un espoir à travers lui celle d’avoir des relations même non sincères. Il donne accès à l’autre la capacité de se complaire de sa force, et c’est sa morale économique qui le pousse au meurtre alors qu’il pourrait juste donner sans rien recevoir et se complaire de l’image pornographique de ce qui arrive, de la jouissance de l’autre sans en faire partie. Il ne se rend pas compte qu’il fait tout de même partie s’il pouvait se considérer comme ignare, et ne pas se laisser berner par sa propre image. Le lecteur a une empathie pour celle qui n’est pas considérée et juste utilisée, alors qu’il peut la voir comme un être sensible qui aurait besoin de réciprocité et d’échange plus que de projection.
La double contrainte
Le meurtre dans l’intime est l’expression d’une impossibilité. Le narrateur n’a évolué pour arriver à cet endroit que dans l’insconscience d’un respect d’une morale des apparences héritées de ses parents et de son milieu, dans le but de se conformer. Il ne peut entrer en relation sans avoir le regard parental qui le prive de relations sincères entrer en conflit d’une vraie rencontre. Ses relations ne le sauvent pas car suivent le schéma parental qu’il n’adhère pas lui même.
La peur Les relations du narrateur sont basées sur la peur, la peur du regard des autres, de se faire pointer du doigt, et ne pas être comme un autre. Peut être est ce une peur primaire qui s’est développée pour créer un système où la frontière est ténue entre un monde de confiance et un monde de violence. Le visage dévoilé dans les relations intimes est celui d’une logique du un contre tous. Ce délire rappelle la peur naturelle qu’il y a à aller vers l’autre, peur légitime et qu’il faut affronter, celle d’une indifférence presque salvatrice de l’autre, la peur devant être plus du côté de l’autre, que du narrateur qui se connait. Peut être tue-t-il après l’acte quand il comprend qu’il ne peut donner plus et qu’il sait que malgré ses efforts il n’est rien pour l’autre. D’un certain côté, la victime essaye de se mettre dans un rôle et n’affronte pas ses peurs, ses vulnérabilités. Le tueur lui rappelle que l’on peut demander à ne pas être seul à affronter son ombre, que le rôle que joue l’autre l’empêche d’être elle même et qu’aller jusqu’à l’intime ainsi, sans penser à sa propre mortalité, à sa propre histoire, est comme se permettre d’aller vers la mort sans se relier à soi même. Sa morale un peu sévère est de tuer ceux qui prennent un modèle extérieur pour ne pas penser à qui ils peuvent être.